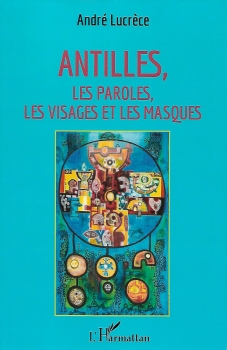
Full size image
L'Harmattan
Dans Antilles, les paroles, les visages et les masques1, le sociologue et romancier martiniquais André Lucrèce livre un essai sur le rôle joué par la culture populaire (mythes, contes, récits) et la littérature dans la construction du monde antillais.
Cet ouvrage part du questionnement suivant : « Les Antilles interrogent. Comment ont-elles pu exalter un tel souffle à partir d’un si indéchiffrable désordre historique, quelle mémoire oubliée dormait dans cet éventail d’îles ? Peuples bigarrés, langues disparates, cultures hétéroclites, religiosités chamarrées, aboutissant à des créations mâtinées de lianes : la chose tressée dans la vraisemblance de l’impur et dans une implacable violence ».
C’est donc à la généalogie et aux continuités de cette chose tressée que l’auteur convie ici, dans des développements sur les mythologies, réminiscences, cheminements, errances, habiters, poétiques, pensées… des Antilles.
L’ouvrage commence par l’analyse de mythes d’origine amérindiens. D’abord, celui de Sésé, génitrice du premier Caraïbe. Ensuite, celui de la création des femmes, grâce à l’oiseau Inriri qui à coups de bec dans un corps asexué, creusa là « où se trouve la nature des femmes ». Enfin, celui de Matinino, « l’île sans pères » puis « l’île aux femmes », laquelle deviendrait, au terme de plusieurs variations, la Martinique.
Viennent les réminiscences. Celle de la traite d’abord, au cours de laquelle des Africains raptés, embarqués dans des négriers, endurèrent : « Toutes ces nuits de pénurie et d’angoisse qui tiennent lieu de sommeil, tous ces matins, enchaînés aux cales et dans l’entrepont, sans ciel, sans perspective. Et quand la mer se lève, quand elle se déchaîne, ce sont les corps qui subissent ces moments noirs et les vomissures qui se répandent en promiscuité insupportable ».
Et aussi le souvenir du fouet, qui estampa les corps des évènements que subirent les esclaves : « Le grouillement des cruautés est alors infini quand le maître façonne le corps de traces inhumaines inscrivant des évènements faits de saccages volontaires et de prédation ». Car alors, comme le rappelle Aimé Césaire, « Battre-un-nègre, c’est le nourrir ».
Souvenir également d’autres faits révélateurs du désabri général dans lequel fut plongé l’asservi, livré à des moines-soldats comme Jean-Baptiste Labat, chargés d’extirper par le fer, le feu les pratiques religieuses africaines. Ou quand parfois l’esclave fut obligé, pour le profit de ses maîtres et maîtresses, de voler, se prostituer. Et face à tout cela, sa parole inaudible.
En un lieu cependant, Saint-Domingue, la parole de l’esclave fut audible : « La liberté ou la mort ». Il força à l’entendre et ce fut la liberté, grâce à l’épopée dessalinienne, à l’héroïsme de Capoix-la-Mort, vainqueur de Vertières.
Suivent les cheminements. Là, Lucrèce s’attarde sur des productions symboliques comme le carnaval, « propriété des peuples […], récit de l’éternel retour qui installe les mythes, les chants, la musique, le rire, la liberté des corps en rupture des jours amers et de la banalité quotidienne ».
Ou encore le conte qui, « dans sa composition intelligible, est le rouleau de la mémoire […], la vérité du réel exprimé dans l’imaginaire. [Sa] chair est la récapitulation des actes symboliques […]. Le conte est la fête bruissante de la parole où l’ingénuité se fait rusée, prodigue et fertile en son mouvement ».
André Lucrèce consacre également des analyses aux écrits qui tentent de cerner la réalité antillaise. La revue Tropiques, créée en 1941 par Aimé, Suzanne Césaire et Réné Ménil, suscite son enthousiasme : « vous y trouverez ce qui jamais ne s’est vécu aux Antilles à ce point : le murmure passionné de l’esprit déjouant une inexorable contrition nous amenant à déchoir […] Tropiques, c’est ériger la vie en manifestation du merveilleux à partir de l’inventaire ».
Puis l’auteur s’attarde sur le concept de créolisation, rappelant qu’il est relativement ancien puisqu’apparu, comme l’a repéré Jean Benoist, dès 18842. Lucrèce le définit ainsi : « la créolisation, c’est l’histoire des différences mises le plus souvent brutalement en contact par des actes de conquête et d’exploitation de richesses qui supposent également l’exploitation des hommes. C’est ce qui s’est passé dans la Caraïbe. Il ne s’agissait pas de mise en relation cordiale de cultures diverses, mais d’un processus de miscégénation imposé par les conditions historiques de l’installation autoritaire et violente des colonisateurs européens sur le sol des îles »
En cela, il s’oppose à Édouard Glissant, pour qui « La créolisation exige que les éléments hétérogènes mis en relation “s’intervalorisent”, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de dégradation ou de diminution de l’être, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur, dans ce contact et dans ce mélange ».
Lucrèce refuse par ailleurs d’associer, comme le fait Glissant, la créolisation historique, qui concerna la Caraïbe, et le processus culturel de la globalisation actuelle, lequel serait, pour Glissant, une créolisation en cours.
Sa critique porte encore sur la notion glissantienne de migrant nu, bossale qui serait arrivé aux Antilles dépouillé de tout, à qui Lucrèce oppose les habits précieux du migrant, soit « la constellation spirituelle qui le protège[a] de la déshumanisation », et les armes qui plus tard lui permirent de reconfigurer les traits culturels imposés.
Mais c’est à la littérature non analytique que Lucrèce consacre le plus de pages. Par exemple, aux Mains pleines d’oiseaux de Joseph Zobel, qui « décrit l’animation du vivre sous le soleil de l’anse qui illumine une sorte d’innocence sociale, loin de l’exploitation capitaliste ».
Ou L’espace d’un cillement de Jacques Stephen Alexis, spectacle de l’Éros : « Envelopper l’être désirable, l’autre de nous-même, qui aussitôt perçoit dans les yeux la malice d’abord, puis la lumière exquise de la floraison ».
Ou encore Le sel noir d’Édouard Glissant. Là, « l’image est acoustique, comme un charroi profond et sourd, venant de loin, chaotique aux trouées ».
Et aussi les ultimes poèmes de Magloire Saint-Aude : « Avant de cheminer dans la pénombre d’un apaisement, le vent fermant la porte au souffle matinal et à la grâce de ses lampes jusqu’aux derniers tremblements des paupières »
Enfin, Lémistè de Monchoachi : « L’office de la parole dans la rumeur des voix proches où les lèvres se répondent dans une ravine d’ombres ».
Ce livre à la langue ciselée, parfois acérée, volontiers sensible, est un travail érudit sur les conditions d’émergence, d’expression d’une civilisation archipélique. Il en raconte donc la genèse, les douleurs, les interprétations, réinterprétations. Et encore la beauté.
