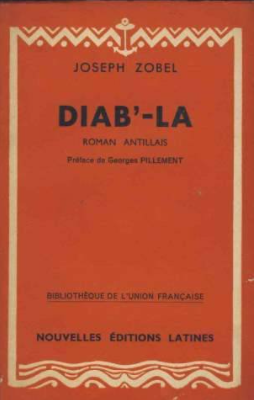Introduction
Il est des succès populaires qui réduisent la dimension véritable d'un écrivain. Celui du roman de Joseph Zobel, La Rue Case-Nègres, paru en 1950 – et grandement amplifié par le film qu'il inspira à Euzhan Palcy en 1983 – est de ceux-là. Les qualités de ce chef d’œuvre d'inspiration autobiographique expliquent un attrait quasiment universel. Le dévouement de M'man Tine – pour éviter à son petit-fils, José Hassam, le destin commun des jeunes nègres dans les champs de canne à sucre de la Martinique coloniale des années 1920-1930 – est admirable, et le caractère exemplaire de l'histoire a pu cacher les qualités de l’écriture, qui sont celles d'un roman réaliste à la première personne, parfaitement maîtrisé dans la construction et dans le style.
Or, quelques années avant ce roman, était paru Diab'-là2, une œuvre qui continue à rester dans l'ombre de son successeur, alors même que sa sortie officielle à Paris le 26 mars 1947 – manifestement orchestrée par les Nouvelles Éditions Latines et le ministère de la France d'Outre-mer (qui avait récemment remplacé le ministère des Colonies) – avait suscité des comptes-rendus enthousiastes3. Au-delà de l'heureux succès de cette publication, il est intéressant de se pencher sur la genèse de l’œuvre qui eut lieu dans le contexte bien moins euphorique de la Seconde Guerre Mondiale, laquelle avait sérieusement bousculé les conditions existentielles, politiques et culturelles, tant en Métropole que dans les colonies.
Ainsi, la rédaction de Diab'-là s'inscrivit dans le chaudron caraïbe des années 1939-1945, où se croisèrent trois courants esthétiques que je qualifierai de dissidents par rapport à la littérature conventionnelle : la négritude, le surréalisme et le réalisme merveilleux. Rappelons qu'après douze années passées en France, Alejo Carpentier, proche de Desnos, de Damas, de Baghio'o et des surréalistes à Paris, et futur prophète du real maravilloso, était rentré à Cuba en 1939, avant de visiter Haïti en 1943 ; et qu'André Breton, pape d'un surréalisme assez ébranlé à cette époque, fit la connaissance de Césaire et de sa stupéfiante poésie, alors qu'avec Wifredo Lam et Claude Lévi-Strauss, il faisait une escale (dans des conditions honteuses) à Fort-de-France en 1941, avant de s'exiler à New York – et de visiter lui aussi Haïti, en 19454, où vint l'écouter notamment J.S. Alexis, futur théoricien du réalisme merveilleux des Haïtiens.
Mais, parmi les noms de cette constellation d’écrivains et d'artistes du vingtième siècle, il manque celui de Jean Giono, l'auteur qui a certainement publié l’œuvre narrative la plus substantielle, en langue française, dans ce qui a souvent été appelé le « style du réalisme poétique » et que j'ai, pour ma part, redéfini comme le « mode narratif du réalisme merveilleux ». Car au-delà de certains thèmes communs, propres au roman « paysan », c'est la parenté d'esprit et de technique narrative entre les romans du Giono dit « de la première manière » (1928-1942) avec ceux d'auteurs antillais de l’après-guerre comme J.S. Alexis, Simone Schwarz-Bart ou Jean-Louis Baghio'o, qui saute aux yeux – et au cœur5. Et si Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, publié en 1944, peut être considéré comme le premier chef d’œuvre littéraire du réalisme merveilleux haïtien, bien avant qu'Alexis ne vînt en présenter les prolégomènes à Paris en 19566, j'arguerai que, en 1942, en plein tan Robè – alors même que Giono, écœuré par sa mise au cachot pour pacifisme à l'automne 1939, renonçait à son engagement communautaire pour méditer un nouveau style de narration, encore plus anarchiste mais cynique, qu'il allait illustrer dans ses « chroniques »7 ; et que Breton, à New York, manifestement découragé, rédigeait des « Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non [sic] »8 – Zobel achevait, lui, le premier chef d’œuvre martiniquais du réalisme merveilleux : Diab'-là.
Photo 1. Première de couverture de Diab'-là
1. Diab'-là : éléments du contexte de création et de réception
On sait avec quel intérêt les Antillais ayant bénéficié d'une éducation scolaire pendant la fin de l'ère coloniale ont toujours suivi les productions littéraires de la métropole, et l'on ne peut douter que Zobel, une fois installé à Fort-de-France, entre Lycée et Bibliothèque Schœlcher, était aux premières loges pour découvrir, notamment, les premières œuvres de Jean Giono, publiées chez Grasset. Or avec des romans comme Colline, Un de Baumugnes, Regain ou Que ma Joie demeure, l'écrivain de Manosque avait apporté une extraordinaire bouffée d'oxygène dans le paysage littéraire français d'avant-guerre. Puis, avec ses essais, Les Vraies Richesses (1936), Refus d'obéissance (1937), Le Poids du ciel, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix (1938), Recherche de la pureté (1939), Triomphe de la vie (1942)9, le « mage du Contadour » avait suscité pour toute une génération d'esprit dissident (anarchiste, pacifiste et antifasciste), un sentiment d'exaltation et le désir de changer le monde, de changer la vie10. Cette écriture enthousiasmante qui lança Giono fut appelée rétrospectivement celle de la « première manière » de l’écrivain, et rebaptisée, dans mes travaux, par celle du « réalisme merveilleux ». En lui associant une définition précise d'un mode narratif de la fiction11, cette appellation permet en effet de rendre compte de la spécificité de presque toute l’œuvre du Giono d'avant-guerre – romans, autobiographie et essais confondus12.
D'autre part, le recours à la notion de réalisme merveilleux met en évidence des sympathies manifestes entre l'écriture de ces textes gioniens et celle d'écrivains antillais et latino-américains, habités d'un élan créateur similaire13, mais souvent associés – pêle-mêle dans la critique – à de vagues définitions du surréalisme et/ou du réalisme magique. Or, il me semble que l'on retrouve dans Diab'-là (et dans une grande partie de la production littéraire de Zobel14), non seulement beaucoup des mots-clés des œuvres du Giono d'avant-guerre, mais aussi un mode de narration très particulier où le réalisme le plus prosaïque côtoie en permanence le mystère cosmique, sans que cette cohabitation ne crée l'inquiétude, propre au fantastique, ou le merveilleux, volontiers hétéroclite, du surréalisme ou de la poésie d'un Césaire, réputée ésotérique. Au contraire, dans les œuvres réalistes-merveilleuses, la geste des personnages et les décors s'inscrivent, sans couture visible, à l'intérieur d'un monde à la fois naturel et mystérieux. Ces aspects – potentiellement antinomiques – se fondent dans le creuset d'une narration emportée par l'exaltation poétique : voix des personnages et voix des narrateurs vibrent avec celle – implicite – de l'auteur. Toutes unies au même diapason, elles soufflent un vent panthéiste lyrique d'une force peu commune. Chez Giono surgit, dès La Trilogie de Pan, l'évocation puissante d'un monde à la fois chtonien, parfois encore proche d'un chaos originel, et plutôt idyllique, que l'on retrouve esquissé dans Diab'-là15.
Ni les aspects réalistes ni la poésie des œuvres de Zobel n'ont certes échappé à la critique, mais elle est souvent partagée entre des lectures mettant en avant soit le réalisme social, soit la négritude – la forme d'engagement à la fois poétique et politique, contemporaine de Zobel16. Ce que l'on veut montrer ici, c'est comment le mariage heureux et constant du réalisme et du poétique, codes a priori antinomiques, caractéristique du réalisme merveilleux17, domine la narration de Diab'-là18.
2. Diab'-là : récit et paratexte
Si l'histoire racontée dans Diab'-là est assez simple et assez vraisemblable pour s'inscrire globalement dans le réalisme, il faut noter que les deux textes liminaires du roman apportent d’emblée des éclairages particuliers, assez éloignés d'une froide objectivité. Ainsi, la note, datée Fort-de-France, le 15 avril 194519 – et apparemment conçue dans l'esprit d'un « prière d'insérer » – évoque de manière émotionnelle les difficiles conditions existentielles et politiques des Antillais dans la période de Vichy. Il y est question de « compatriotes gémissant dans les ténèbres » – expression évoquant bien sûr des images de l'esclavage et la traite – par-delà des mentions de « censure » et « d'amour de mon pays et de mes congénères » (p. 8), se référant elles à une catégorie de la population, maintenue dans l'ignorance sur le sort de l'île entre 1939 et 1943, par des politiques racistes20.
Cette note, relevant donc d'une forme d'affirmation de la négritude, est suivie de deux pages énigmatiques, intitulées « En guise d'introduction », présentant un dialogue très stylisé, autour d'un punch, entre l'auteur et un personnage non-nommé, qui l'encourage, lui, le nègre, à écrire plutôt qu'à seulement raconter des histoires de nègres. La situation d’énonciation est voilée, et seuls les conoscenti parmi les lecteurs étaient (ou sont) susceptibles de reconnaître dans ces lignes sibyllines un hommage à Césaire, qui encouragea les débuts de l’écrivain Zobel21. Le poète de la négritude est campé ici comme public privilégié du conteur Zobel (comme il l'a été à cette époque), un Zobel qui prétend lui raconter, en commençant par l'interpellation rituelle « Et krik », l'histoire de Diab'-là, alors même qu'il va initier un roman écrit dont on verra, justement, qu'il a très peu à voir avec le genre du conte antillais. Par contre, cette introduction contient un passage programmatique de l’œuvre qui suit :
Je vous racontais une histoire vraie, que j'oublie pourtant déjà. C’était, je crois comme un mauvais poème où nègres, canne, sueur, misère, colère, rimaient affreusement. Et une autre histoire imaginée, de soleil, liberté, amour, joie. (p. 11).
Il est clair pour tout lecteur du roman, que c'est l'histoire « imaginée » et pleine de « joie », que Zobel va développer, en transcendant la réalité par le merveilleux22. Et c'est par des éclats appartenant au code du mystère – allusions à la négritude, dans une situation historique pénible, et à une volonté de dépassement des affreuses réalités du passé, par amour et par la poétisation, affirmée face au grand poète martiniquais – que les deux textes liminaires ouvrent le roman.
3. Codes du réalisme et code du mystère
Le roman lui-même est assez court (quelque 160 pages, aérées) et l'histoire se développe chronologiquement dans une succession de 14 chapitres sans titre ni numéro, allant de 4 à 23 pages. Il s'agit plutôt d'une série de tableaux que d'une intrigue construite. Le nombre des personnages est restreint, avec, au premier rang : le trio Diab'-là, sa compagne Fidéline, et Capitain'-là ; au second : Jérôme, Man Mano, Ti-Jeanne, et Soun ; et plus loin, une dizaine d'autres noms évoqués occasionnellement. Le cadre est celui du village de pêcheurs du Diamant et de quelques mornes environnants, vers 1940, à une époque encore sans électricité et sans touristes. Les seules intrusions du progrès technique sont l'autobus de 'la postale', faisant la navette jusqu'à Fort-de-France les jours de semaine, et un gramophone à manivelle.
Dans ce décor, présenté de manière plutôt idyllique malgré d'occasionnelles intrusions de l’adversité sous forme de sécheresses, d'orages ou de disparitions de bateaux en mer, se déroule une action en chapitres-tableaux dont le noyau est l'installation au village du héros, Diab'-là23. Ce nègre solitaire, courageux et fier, venu d'un morne voisin et las de travailler pour les grands propriétaires de plantations, s'attaque à cultiver les terres en friche, se met en ménage avec Fidéline, une femme du cru, avec le soutien de laquelle il dynamise si bien la vie économique et sociale du village – en produisant localement force légumes, en introduisant le « coup de main » solidaire pour les gros travaux et en organisant des soirées dansantes chez l'un ou chez l'autre – qu'il est accepté par tous. Et notamment par l’érudit du lieu, Capitain'-là, surnommé aussi « l'Anglais », un homme à la retraite, généralement critique de la situation coloniale de la Martinique, et si impressionné par l'action de Diab'-là qu'il vient un jour lui apporter du poisson frais dans sa maison sur le morne. Le livre se termine par la description du repas de fête impromptu, préparé par Fidéline avec les légumes produits par Diab'-là et le poisson de Capitain'-là, dans une célébration joyeuse des « vraies richesses » réunies de la terre, de la mer et de l'amour (Fidélise est enceinte), « comme s'ils entonnaient un hymne d'espoir devant une aube nouvelle » (p. 174).
Photo 2. Joseph Zobel au Diamant en 1937
Source : Écomusée de Martinique, Rivière-Pilote – CTM
Une analyse détaillée du roman mettrait en lumière comment les divers épisodes de l'action sont narrés d'une manière qui allie constamment le réalisme (dans sa définition très basique, centrée sur le concept de vraisemblance) et le mystère de la création (dans les rapports entre les hommes et la nature environnante ; ou dans les rapports des hommes entre eux au sein d'une culture caribéenne spécifique, dans laquelle les gestes, les coutumes, le langage des oiseaux ou celui des tambours, par exemple, ont des signification locales, souvent indéchiffrables pour l'étranger). Cette imbrication se manifeste d’emblée dans la description de la bicoque des Sept Péchés, comme « le pouls du village » du Diamant – vu de l’intérieur par un narrateur qui s'associe à un 'on' collectif: « On était là, comme tous les soirs... » (p. 23) – puis dans le fait que les personnages ne sont présentés qu'avec des prénoms ou des surnoms, qui les campent dans des rôles à mi-chemin entre des personnages de conte et de roman réaliste. A la réflexion, il est assez plaisant que le catholique croyant Zobel plante l'incipit du roman dans un lieu appelé Les Sept Péchés (lieu de perdition, donc, où les hommes boivent, fument et jouent aux dominos – les hommes seulement « car la place des femmes n'est pas dans un privé, ni pour boire ni pour faire la fête », p. 17) et permette à son protagoniste d'adopter le surnom de « Diab'-là », qui surprend même son premier interlocuteur dans le village, le jeune Jérôme, « qui ne sut quelle contenance adopter » (p. 24). Avec un tel surnom, le défi du paysan des mornes, venu s'attaquer à la dure terre du Diamant, prend d’emblée une dimension épique, touchant au mythe.
Quant à l'harmonieuse relation qui s’établit dès la première nuit entre « l'homme » Diab'-là et « la femme » Fidéline, si elle séduit les lecteurs, c'est qu'elle relève bien plus d'une combinaison aussi improbable que miraculeuse du fantasme sexuel et du conte de fée, que d'un quelconque réalisme. La « gonzesse » réclamée à Jérôme pour la nuit s’avérera être la partenaire idéale tant au lit que dans les jardins et au marché, avant de devenir la mère des enfants de ce nouveau couple adamique24. Cette réalité-là paraît pour le moins merveilleuse25.
Après cette révélation de l'accord immédiat entre Diab'-là et Fidéline, plusieurs chapitres développent l’intégration rapide de Diab'-là dans la société du village. L'aisance et la détermination de Diab'-là en imposent à tous les hommes du Diamant. Bientôt « Diab'-là et Jérôme ne se quittèrent guère » et Diab'-là prend place, dans « la jovialité des Sept Péchés », au « décollage » matinal comme aux jeux de domino le soir, bien qu'il refuse, en tant que « terrien », de partir en mer. La réalité du village (rustique, mais merveilleuse) est décrite par petites touches poétiques alternant avec de courts dialogues entre divers personnages du lieu. La bonhomie règne dans une communauté présentée comme idyllique (notamment dans le naturel des relations sexuelles : le soir, « un gars rôde en sifflant une invite de mâle en désir ... » ; « les jeunes gens […] allaient faire l'amour avec les jeunesses des mornes »), et le narrateur, a priori hétérodiégétique, participe de cette communauté par l'usage récurrent du style indirect libre et du « on » : « dans l'ombre des cocotiers, on remaille les filets […], ou bien on reste dans la cour de la case ».
Si au début, Diab'-là se sentait un peu comme « un paria dans ce village nouveau », « il ne lâchait pas son rêve » et obtint bientôt une première parcelle de terre à cultiver de M. Alfred, l'instituteur. À partir de là, ses efforts sont rapidement récompensés, à la fois en termes de récoltes de légumes et en termes de réputation, surtout lors d'une vente un dimanche à la sortie de la messe, où « Fidéline faisait merveille au milieu de la foule éblouie ». La description de ce dimanche se termine par la fête improvisée devant la maison bourgeoise de Man Sonson, avec son gramophone et ses filles attifées « à la békée vaniteuse », alors que passent, indifférents, deux amateurs de combats de coq, dont les échanges sont cités en créole. Ce sont donc des facettes diverses et contrastées, de réalités sociales typiques d'un bourg antillais que le narrateur présente, de manière toujours soucieuse de souligner l'harmonie d'une société dans laquelle les ombres, les querelles ne sont que passagères.
Le même principe vaut pour les sixième et septième chapitres qui présentent l'infatigable Ti Jeanne, une vieille fille fort dévote, restée fidèle à la mémoire de son fiancé mort en 14-18, possédant une jolie maison et des terres, « collaboratrice du curé » enseignant le catéchisme, cordon bleu cuisinant pour les fêtes, et dont le portrait fait partie des nombreux passages dans l’œuvre de Zobel valorisant la foi et la pratique du catholicisme: « On se demande [..] si, lorsqu'elle s'agenouille au bas de son lit [...], son petit corps ascétique ne se nimbe pas aussi de cette lueur divine qui entoure les saints de ses images » (p. 64). Ce portrait tout en sympathie est immédiatement suivi d'une restriction : « Mais les enfants, et en particulier les petits garçons, n'aiment pas Ti Jeanne. Car elle est inexorable pour les paresseux [et odieuse pour les 'troubleurs' de messe...] », péchés qui valent toutes sortes de punitions aux coupables, fessées rageuses et privations... Parmi les garçons, le petit Soun est distingué pour être « un petit vagabond débrouillard » qui est fier de gagner des pièces de-ci et de-là pour aider sa mère souffrante. Le dialogue animé et instructif entre Soun et ses copains est présenté de manière très vivante et s’achève sur un bain de mer improvisé « avec une immense piaillerie », d'enfants libres et heureux dans leur environnement, malgré les brimades occasionnelles.
Le huitième chapitre est, avec le dernier, le plus long du livre et en constitue le cœur symbolique par son insistance sur la solidarité dans la communauté : deux « coups de main » initiés par Diab'-là y entourent une grande pêche qui finira par donner lieu à une fête aux Sept Péchés, même si un bateau n'est pas rentré, que le petit Soun, notamment, fait partie des victimes présumées du « miquelonnage » (la pêche au large) et que l'angoisse étreint les cœurs pendant plusieurs jours. Comme toujours dans le roman, la description de ces événements, pour vraisemblables qu'ils puissent être, est assortie de touches suggérant le mystère (celui de la fatalité entourant la disparition d'un bateau ; celui de l'origine et de la signification des battements de tambour appelant à sortir de nuit – il s’agira d'aller fouiller la terre en haut d'une ravine pour les fondations d'une case pour Asto, qui veut se marier), et exprimée par le narrateur avec une connivence enthousiaste : « Diab'-là allait donc attaquer le sol […], seul pour vaincre la terre ingrate […], pour planter la vie ! » (p. 75). Et quand Diab'-là suggère « un coup de main » aux copains des Sept Péchés, « l'idée de cette affaire devint de plus en plus alléchante […], c’était aller mettre un peu de joie en terre ! », projet qui se termine par un beau repas communautaire sur le Morne Blanc, et un commentaire très pan-africaniste et/ou boy-scoutard, mis dans la bouche d'Asto : « Messiés, si un beau jour tous les nègres du monde voulaient se donner un coup de main, quelle sacrée victoire, hein !... » (p. 78). Et quand Asto bénéficiera lui-même d'un coup de main, auquel tout le village se mettra, le narrateur – dans le plus pur style du Giono panique – fera chanter « la terre qu'on crève » de concert avec « les cris fauves des hommes essoufflés », « comme si c’était la terre traquée qui braillait par toutes ses blessures » (p. 92).
4. Fusion des codes et exaltation auctoriale
On peut noter dans les courtes citations ci-dessus, comment la description des réalités physiques du travail de la terre est traduite en images presque fantastiques dans une vision panique de la vie du village à l'occasion du coup de main : de toute évidence, la narration est emportée par une exaltation auctoriale, glorifiant cette expérience collective. Le chapitre suivant est dédié à l'introduction par Diab'-là, d'une tradition encore inconnue au Diamant, celle du « lancer de bouquet » pour organiser des bals successivement dans les maisons des villageois. Non pas des danses créoles comme le bèlè, mais des danses venues de la ville pour lesquelles une « grande tenue » (habits de fête et chaussures) était de rigueur. Le premier, donné chez Diab'-là et Fidéline, est décrit comme « un bal de rêve », alors que le second, à l'Anse Cafard, manque de tourner court en raison d'un couple surpris à faire « l'amour cochon » dans la chambre des hôtes, alors « qu'on s'amusait en gens de bien » (p. 108). C'est Diab'-là qui sauve la soirée en assurant à l’hôtesse indignée que : « Man-maille, cé rien », « ça se fait même en France ». Un tel commentaire ne peut relever que du on-dit (ni Diab'-là, ni l'auteur du roman n'ayant été en métropole...) mais le narrateur exprime – à nouveau sous la plume de Zobel, et ici par la bouche de Diab'-là – la tolérance de relations sexuelles en dehors des conventions religieuses ou bourgeoises, en sus du plaisir social de la musique (jouée surtout par l’accordéon) et de la danse.
Une sensualité analogue est exprimée à nouveau dans le court mais très poétique dixième chapitre, décrivant l’arrivée de la pluie après le carême « comme un gigantesque cheval blanc tout fumant de sa course », avec des enfants nus « dansant et criaillant comme à une fête diabolique », la femme écoutant la pluie dans une case où « le souffle de l'homme est une invite à l'amour », et Diab'-là et Fidéline dînant d'un punch au lait, pendant que « dehors, la pluie tant désirée […] fécondait la terre, la nuit et la joie des hommes » (pp. 113-117).
Réalisme et mystère se conjuguent à nouveau dans la section suivante, consacrée à la rencontre entre Diab'-là et Capitain'-là, l’énigmatique doyen du Diamant, surnommé « l'Anglais » et respecté pour sa fierté (« Je suis un nègre, avec la liberté dans le sang ! »; « Tous les jours, je vous le répète : c'eût été moi si Schœlcher n’était pas venu. »), ses voyages et ses connaissances. Il fallut qu'Asto et Jérôme réunis fassent l’éloge de Diab'-là (qui, selon eux, est « appelé à être un maître parmi les hommes ») pour que Capitain'-là souhaite le rencontrer. Cela se passe un dimanche, et il est intéressant de noter que Diab'-là se rend chez Capitain'-là en grand habit (costume, col dur, cravate, giletière d'or massif, chaussures vernies...), bien différent de sa tenue habituelle de paysan en « trois-quarts de pantalon et blouse sans collet ». Et si les deux hommes s'accordent merveilleusement sur tous les sujets abordés, l’épisode se termine, de façon assez peu caractéristique pour le roman, par des remarques pessimistes d'un narrateur en focalisation interne sur Capitain'-là. Celui-ci, après avoir estimé que « nos nègres ici se contentent de franchir quelques barrières et de tourner le dos aux leurs », « bouillait en lui contre un système d’éducation dont il sentait à même sa peau toutes les erreurs et les stupidités », de sorte qu'il dut se contenir en prenant le punch de l’amitié avec Diab'-là, car « il sentit que sa gorge était resserrée et son cœur gonflé d'amertume ».
L'exaltation auctoriale reprend le dessus, comme « la verdure se relevait après la pluie », dans le chapitre 10, qui fusionne les pouvoirs mystérieux de Diab'-là pour retrouver le beau giraumon disparu, avec la description du travail de la terre par le couple. Si bien qu’après « des journées de labeur passionné, […] ils 'sen allaient chargés de leurs richesses […] de leurs pas volontaires sur le monde » pour vendre leurs « légumes tou lé jours » au village. Et si la Toussaint donne lieu à quelques querelles de femmes pour un certain Tintin autour des modestes fosses du petit cimetière, pour Diab'-là, « devenu Diamantais », c'est une « fête de la Résurrection » qui se termine, de façon fort peu liturgique, avec des rires et des danses aux Sept Péchés.
Le roman lui-même se termine en apothéose par un long chapitre narrant – avec à nouveau des formules d'un lyrisme tout gionien – comme : « A ! Ces fins d’année, comme elles comblaient Diab'-là de tout ce qu'elles apportaient de fécondité, de paix et de joie »; « Et il n’était pas jusqu’à ses moments de mutisme qui ne s’imprégnassent du lyrisme latent de cette grande exaltation de la nature... » (pp. 151-152). La consécration de Diab'-là est apportée par Capitain'-là, qui monte partager trois poissons frais avec Diab'-là et Fidéline dans leur case du Morne Vent. Ces pages offrent de nouveaux exemples d'intégration des citations en un français familier et légèrement créolisé de Diab'-là avec celles plus précises et châtiées de Capitain'-là, dans le discours poétisé du narrateur :
Il regarde Capitain'-là, avec un air de plus en plus émerveillé, puis il reprend :
Sans mentir, Capitain'-là, les autres jours je suis dans un ti pressentiment de te voir... […] Eh bé, j’étais à manœuvrer le 'mayoumbé' […] alors je calculais... Enfin, les tites affaires comme ça... […]
Et moi, dit [Capitain'-là], ce matin, je suis allé du côté des Fous lever une nasse […]. La mer était chiffonnée ces temps passés, et elle me brutalisait trop. Mais mon cher, sitôt que j'ai amené monter et que j'ai vu le couronné qui tapageait là-dedans... […].
Des oiseaux sautillaient de branche en branche et épongeaient dans l’épaisseur des feuillages, comme des flèches volantes et sifflantes.
Fidéline s’empressait de rincer les pots de fer-blanc pour servir le punch... (p. 156).
La visite de Capitain'-là aboutit à un festin improvisé où les voix des deux hommes se conjuguent avec celle du narrateur pour chanter et la terre qui, fécondée « par la bonne sueur du nègre », donne l'igname douce et « ce bien-être qui les comble et les magnifie » ; et la mer « qui donne du poisson, qui donne de la santé » – et qui « donne aussi la joie » (pp. 164-167). Les réalités de la grossesse de Fidéline et du contrat de location de cinq carrés de terre, que Diab'-là va signer chez le notaire avec Ti-Jeanne, donnent lieu à un commentaire auctorial lyrique : « Ils souriaient tous les trois, de ce sourire débonnaire, placide que dégage l’évaporation sereine de l’allégresse » (p. 169). Mais c'est dans la bouche de Diab'-là que Zobel met un long passage, avec « ses mots simples » et « son cœur simple », sur son passé d'homme « qui n'a pas froid aux yeux (man-maille-là dit je suis un Diab') » et qui a quitté l'usine à sucre pour donner toute sa sueur pour sa propre production, car « cette fatigue-là, cé de la joie qui entre là, cé pas comme l'autre qui est la misère. […] Je donne... Je suis riche ! Vous comprenez... » (pp. 170-171).
Capitain'-là est touché par ce discours et le narrateur décrit deux hommes qui devinrent pensifs, jetés « tantôt dans un accès de colère sourde, tantôt dans des affres de désespoir, parfois dans des illusions de triomphe ». Mais le texte en reste à ces allusions à une situation économique et politique globale de l’île, manifestement peu satisfaisante, voire inacceptable, puisque Diab'-là en vient à affirmer que : « Eh bé ! Capitain', ce que je veux dire, ce que ça doit changer à partir d'aujourd'hui... », et Capitain'-là de surenchérir, en élevant la voix, que : « Oui, il nous faudra […] recommencer, pour mettre nos plants et semer des grains à nous pour nous-mêmes ». Mais on est très loin ici, d'un quelconque engagement politique ou syndical, comme le glorifiait Roumain dans son roman contemporain, Gouverneurs de la rosée, et le narrateur se contente de commenter que « leurs paroles avaient des bruits de combat et de chaînes brisées », avant de revenir à l'enchantement de la situation concrète des devisants, seuls sur un morne dominant le village du Diamant, par l’intermédiaire de Fidéline, qui leur fait remarquer la belle musique que le manguier s’était mis à faire sous l'effet de la brise. Si bien que l'exaltation auctoriale finale du roman s'exprime dans des images liées au présent : « Peu à peu, ils se sentirent revenir au ravissement du moment, et ils recommencèrent à parler lentement, comme s'ils entonnaient un hymne d'espoir devant une aube nouvelle » (p. 174).
Là aussi, les similarités de thème comme de mode narratif avec un roman de Giono sont frappantes. A la fin de Regain, le héros Panturle se retrouve avec la femme qu'il a conquise, enceinte, dans le hameau qu'il a ressuscité par son travail acharné de la terre :
Maintenant Panturle est seul. […] Il marche. / Il est tout embaumé de sa joie. […] / Il est devant ses champs. […] Il prend une poignée de cette terre grasse, pleine d'air et qui porte la graine. C'est une terre de beaucoup de bonne volonté. […] / Alors, tout d'un coup, là, debout, il a appris la grande victoire. […] Il est solidement enfoncé dans la terre comme une colonne. (pp. 335-336)
Photo 3. Joseph Zobel à Paris en 1950, présentant Diab’-la à la Foire du livre d’Outre-mer et saluant le président Vincent Auriol
Source : Écomusée de Martinique, Rivière-Pilote – CTM
Conclusion
Cette brève analyse devrait avoir montré que Diab'-là n'est ni un « charmant » roman de mœurs antillaises (comme le suggérait le préfacier George Pillement), ni juste un autre roman paysan régional, ni un pamphlet indépendantiste (malgré quelques allusions à une situation politique et sociale injuste pour la majorité des Martiniquais, et à l'espoir d'un changement), ni même un roman engagé dans l’esthétique du réalisme social ou socialiste (comme le sera Compère Général Soleil d'Alexis). Car si Diab'-là impressionne les pêcheurs du Diamant par son refus viril de travailler pour les grands exploitants békés de la terre antillaise, il ne remet pas en question le droit à la propriété et il dépend, pour son travail d'ouvrier agricole, des locations que l'instituteur ou Ti-Jeanne ou d'autres petits propriétaires de terrains en friche, veulent bien lui accorder. D'un point de vue social et économique, sa situation est évidemment très précaire et si son labeur est admiré, il n'est nulle part question que son exemple soit suivi.
Si donc Diab'-là est présenté comme un héros, le personnage ne risquait guère de faire des émules dans le lectorat martiniquais (cultivé par définition, et donc peu susceptible d'aller travailler la terre) des années 1940 ou même plus tard26. Le mérite du roman se trouve certainement moins dans ses éventuelles qualités prosélytiques que dans son écriture remarquable. Or celle-ci ne saurait être réduite à un style, puisque ni les protagonistes principaux, Diab'-là et Capitain'-là, ni le narrateur extradiégétique ne « parlent » la même langue. Si la trame du roman a été inspirée par l’émerveillement de l'auteur pendant les mois de son travail d'assistant géomètre dans la magnifique baie du Diamant dans le sud de la Martinique pré-touristique d'avant 1939, et si sa rédaction a été motivée sans doute par ce souvenir éblouissant pendant les années difficiles du tan Robè, vécues à Fort-de-France, l'effort principal du jeune auteur porte sur la transposition littéraire en français d'une expérience fondamentalement créole27. Le soi-disant parler paysan provençal inventé par Jean Giono dans ces œuvres d'avant-guerre a sans doute été une inspiration pour Zobel, comme l'a été la prose poétique de l’écrivain de Manosque28. Si bien que Joseph Zobel élabore une version antillaise du même mode narratif réaliste-merveilleux que celui créé dans la Trilogie de Pan, en intégrant des caractéristiques du créole dans une prose littéraire française essentiellement poétique. Seul un sentiment profond d'exaltation peut rendre compte d'une telle fusion linguistique, dont Jean-Louis Baghio'o reproduira une variante plus féerique29 avec Issandre le Mulâtre (1949), et que Simone Schwarz-Bart perfectionnera dans Pluie et vent sur Télumée Miracle (1972).
Contrairement à Giono ou à Chamoiseau qui ont changé ostensiblement de « manière » dans leur production romanesque, Zobel affichera, lui, une fidélité remarquable au réalisme merveilleux, même si des évolutions stylistiques sont évidentes, par ailleurs, dans son œuvre – et restent à étudier. Dès Diab'-là, et également dès la première phrase de La Rue Cases-Nègres (« Quand la journée avait été sans incident ni malheur, le soir arrivait, souriant de tendresse ») et jusqu'à l'une des dernières phrases de son journal intime : « Que d'émotions, quelle joie, quelle élévation dans les quatre discours qui ont fleuri les trois premiers quarts d'heure... ! »30, et quels qu'aient pu être les moments de découragement ou de déception, c'est bien l'exaltation poétique – la joie – qui domine dans l'écriture de ce Martiniquais, certainement portée aussi par sa foi religieuse qui s'exprime de façon discrète mais constante dans l’œuvre.