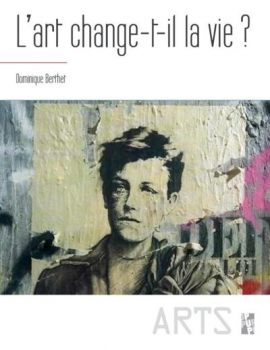
Full size image
Presses Universitaires de Provence
Dans son introduction, Dominique Berthet1 interroge d’emblée l’utilité de l’art. Quatre questions sous-tendent l’ouvrage : « Que peut l’art au regard de la réalité dans ce qu’elle a, à la fois de banal et de terrible ? Quelle est la responsabilité de l’artiste ? Comment le public reçoit-il les œuvres nouvelles et inattendues ? Qu’attendre de l’art ? » (p. 5).
L’artiste participe de et à la vie en société, ses œuvres peuvent avoir un impact sur elle. Face à l’horreur (la guerre, les attentats terroristes, la mort des migrants…), des artistes se sont mobilisés. Déjà, en 1951, Pablo Picasso déclarait que l’art est une « arme ». Et les arts sont porteurs d’une dimension critique, pas toujours directement lisible, traduite de façons très variées. Rappelant les propos de Georges Braque en 1952, D. Berthet constate que les arts du XXIe siècle semblent vouloir troubler, bousculer les mentalités, résister et risquer. Le livre « s’interroge sur la dimension critique de l’art au travers de quatre thématiques : l’utopie, la surprise, la transgression et sa réception, enfin l’engagement » (p. 7).
La notion d’utopie n’est pas seulement associée au futur ou à l’ailleurs, mais s’inscrit dans un présent à améliorer. L’utopie de William Morris (1834-1896), réhabilitant un passé de traditions artisanales, est examinée, avant d’aborder la façon dont les avant-gardes du XXe siècle ont voulu relier art, vie et transformation sociale. L’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest (1942), sensible au lieu, participe aussi de cette question : « Mais si l’art est associé à la vie, peut-on toutefois considérer que l’art est la vie ? » (p. 7). La notion de surprise associe l’insolite, l’audace à l’expérience du trouble qui résulte d’actions parfois illégales dans l’espace public, où le corps (de l’artiste et/ou des participants) joue un rôle déterminant. Les transgressions dans l’art moderne et dans l’art contemporain sont récurrentes, donnant lieu parfois à de nouvelles pratiques. Mais elles sont aussi objets de récupérations qui annihilent leur potentiel critique et suscitent la réprobation. Certes, qui dit création dit engagement de l’artiste, vivant souvent son processus comme une lutte et une nécessité. « Au-delà de l’artiste, c’est la fonction de l’art qui est interrogée » (p. 8). La contre-culture étasunienne des années 1970 fut subversive, mais face à la récupération par les institutions, les mondes de l’art, il s’agit plutôt aujourd’hui, dit D. Berthet, de la ralentir. C’est ainsi que l’artivisme agit depuis une vingtaine d’années en inventant d’autres formes de création pour réveiller les consciences. L’artiste produit des rapports au monde, « organise le chaos », crée des connexions, favorise une « augmentation de vie » (p. 8), ouvre de nouvelles perspectives, imprévisibles.
Dans le premier temps de l’ouvrage, l’auteur développe en matière d’utopie « une pensée de l’autrement ». C’est la célèbre Utopia (1516) de Thomas More, utopie littéraire et politique (non-lieu et lieu du bonheur) qui ouvre cette partie. Sont rappelées les dérives terrifiantes des utopies totalitaires du XXe siècle et cependant en quoi les utopies ne sont pas toutes condamnables. L’utopie moderne naît dans l’humanisme de la Renaissance, ancrée dans l’âge d’or de la tradition antique gréco-romaine. Les voyages de découverte et de conquête, premières utopies, ont développé le mythe de l’ailleurs et la fascination pour les îles antipodiques, paradisiaques. Les dernières explorations au XIXe siècle ont déçu ce rêve. D. Berthet montre que le récit de fiction utopique, construction mentale, rencontre d’imaginaires, permettait dès le XVIIe siècle de critiquer des réalités politiques et sociales. Et « l’utopie pose la question de la relation particulière entre la littérature et le politique. Au fil des siècles, elle devient de plus en plus ouvertement une aspiration et un projet. L’utopie est le lieu de rencontre de la fiction et de l’action » (p. 14). Lorsque les utopies se tournent vers le futur, au XIXe siècle industriel en particulier, ses anticipations convoquent le désir, l’espoir politique d’un changement de société, d’une amélioration, donc un programme à réaliser. On croit au progrès, mais sa puissance destructrice aboutit aux catastrophes de Hiroshima, Nagasaki, entre autres… L’auteur cite les utopies fouriéristes, saint-simoniennes, marxistes, les contre-utopies de Zamiatine, Huxley, Orwell. Le XXIe siècle a vu le retour en force de la pensée religieuse et ses conséquences terribles. Édouard Glissant alerte sur la nécessité de recréer de l’utopie, du mouvement, donc du changement. Ce pourrait être, dit D. Berthet, une « utopie-aiguillon », libérée des illusions, solidaire, pour améliorer la vie, déclencher des actions « réalistes » (E. Morin).
Dans le cadre des utopies sociales du XIXe siècle, la nostalgie de W. Morris pour l’époque médiévale le conduisit à mener un combat militant pour l’art et le peuple. Écrivain (Nouvelles de nulle part, roman de science-fiction), poète, éditeur, Morris voulait revaloriser les métiers d’art, l’artisanat, la beauté, le travail (source de plaisir et non d’asservissement), l’art du jardin, les arts pour le plus grand nombre et s’inscrit dans la pensée de Ruskin pour renouveler l’esthétique et transformer la vie par l’art.
Les propositions alternatives sont d’actualité, comme la mondialité (opposée à la mondialisation) promue par Glissant. L’artiste est un « utopiste », introduisant « dans la vie un autre lieu : celui de l’œuvre. L’œuvre ouvre un autre espace dans le présent » (p. 36). La relation entre art et vie alimenta les mouvements futuristes, constructivistes, conjuguant art et révolution, la vie devenant une œuvre d’art. Plus tard, un artiste comme John Cage abolit la frontière entre art et vie. Les pratiques du collage, de l’assemblage, les diverses hybridations, la performance, le happening, ont repoussé les limites de l’art (Dada, Fluxus, Actionnistes viennois…) en s’appropriant toutes les dimensions du réel. L’importance de l’Internationale situationniste (Guy Debord) et la révolution permanente de la vie quotidienne forment l’utopie concrète théorisée par Ernst Bloch (Le Principe espérance) que D. Berthet nomme pragmatique, « constituant des espaces de résistances multiples face à ce que tentent d’imposer les puissants et en réponse à la folie des hommes » (p. 42).
Le travail d’Ernest Pignon-Ernest relie le lieu, le social et le politique. La ville est considérée comme un matériau « plastique et symbolique » (p. 43). L’artiste crée des situations dans des lieux précis en théâtralisant l’histoire, la mémoire (l’invu de la ville), pour susciter de nouvelles relations, des prises de conscience. Le corps est au cœur de sa pratique.
Dans la seconde partie intitulée « Au risque de la surprise », D. Berthet montre que la notion d’insolite génère rupture, différence, écart, décalage, par rapport à des normes, conventions, habitudes, depuis des siècles. L’imprévu, l’inquiétude, l’étonnement, la provocation, la discrétion sont au rendez-vous. Proche de l’étrange et du bizarre (Baudelaire affirmait que le beau est toujours bizarre), l’insolite a une valeur positive (Dada, surréalisme). Alors l’art serait-il condamné à être insolite ? Marc Jimenez répond qu’un art qui ne le serait pas n’aurait pas de sens. Picasso, Duchamp ont transformé les arts. D. Berthet qualifie ainsi Duchamp d’« insolite radical » (p. 59). Mais l’insolite donne aussi à l’ordinaire une valeur particulière et des artistes comme C. Oldenburg, K. Schwitters, R. Rauschenberg, Arman, rendent esthétique ce qui ne le serait pas a priori, déroutent, recyclent et s’approprient le quotidien, le transfigurent.
Joyeuse, ludique, pratique de la distanciation, scandaleuse, l’audace est une disposition, parfois novatrice, source de défis, de révolutions artistiques. Elle réside à l’intérieur de l’œuvre et peut la mettre en danger ; l’audace, avec sa part d’imprévisible, suscite des rapports entre œuvre et public, provoquant son jugement. Trois moments sont discernables : « l’intention de l’artiste, l’exécution de l’œuvre et l’effet produit lors de la réception » (p. 66). L’audace artistique est-elle toujours pertinente ? Que révèle-t-elle ? « L’audace est un cocktail de nouveauté, de défi et de risque » (p. 67). Certes, elle déclenche parfois l’hostilité, la répression. Elle est toujours de son temps et ne résiste pas à son érosion, à celle du regard. A-t-elle encore un pouvoir de subversion ? L’assimilation l’a affaiblie et c’est la résistance à cette assimilation, à l’institutionnalisation de la révolte qui provoque de nouvelles formes d’audace, change la perception des choses, crée des élans, des prises de conscience.
Selon D. Berthet, le trouble a trois occurrences : le trouble des éléments, celui des émotions et le trouble social. S’ajoutent les troubles comportementaux et mentaux. Le trouble est perturbateur, il brouille, gêne, s’oppose, fait douter, désoriente, crée de l’incertitude, de l’ambiguïté, du malaise. Dans le cas des troubles sociaux, il s’agit d’une agitation, plus ou moins violente, de soulèvements de populations déstabilisant le système. Dans le champ artistique, les combinaisons inédites génératrices de trouble sont infinies et variées. F. Rouan, S. Polke, sont des peintres qui perturbent le regard et brouillent les images, en utilisant des techniques raffinées. Le trouble esthétique naît de la rencontre émotionnelle, imprévisible avec l’œuvre d’art et déjà A. Breton, dans L’Amour fou, soulignait la nécessité de préserver le secret d’attraction des œuvres, le moment de l’approche. Goût et dégoût, selon D. Chateau, attraction et répulsion, sont singuliers, troublants, culturels. Dada, les Actionnistes viennois, l’Internationale situationniste, la contre-culture étasunienne ont créé du trouble politique et artistique. L’exposition « Soulèvements » (J. de Loisy) en 2009 a montré les insurrections de l’art (J.-J. Lebel) et une autre exposition éponyme (G. Didi-Huberman) en 2016, a mis en exergue d’autres actions possibles. L’artivisme actuel s’immerge dans les mouvements sociaux, avec de nouvelles formes d’action, crée du trouble. Ainsi l’œuvre complexe de M. Barney (Cremaster), le scandale de l’exposition « Présumés innocents » (2000), les œuvres controversées de Xiao Yu, mettent le corps en question et choquent les regards et les valeurs, comme le travail politique de Th. Hirschhorn (Crystal of Resistance, 2011) en montrant des corps mutilés.
Dans la troisième partie, « Transgression et réception », D. Berthet est convaincu que l’art a besoin des créateurs ayant remis en question les codes, traçant des pistes inédites (Duchamp, Picasso et bien d’autres). « La transgression est une posture de contestation délibérée vis-à-vis des normes, des codes, des lois, des règles » (p. 95). J.-P. Sartre comme A. Breton ont défendu l’esprit de rébellion contre toute forme d’ordre. Et M. Foucault écrit que la transgression met en exergue la limite. Une limite à dépasser. « Transgresser, c’est donner à voir et à penser autrement et autre chose » (p. 97). Du côté des arts, D. Berthet constate aussi des logiques opposées qui s’affrontent. Ainsi, dans la modernité, les avant-gardes historiques (impressionnisme, fauvisme, cubisme, expressionnisme, dadaïsme, futurismes italien et russe, l’abstraction, le ready-made) ont transgressé, innové, stimulé la création, choqué, déplu. De rupture en rupture, la quête du nouveau est récurrente, au fil de diverses transgressions, plus ou moins spectaculaires. D. Berthet, citant Catherine Millet, montre que l’art contemporain réalise le programme de la modernité, le poursuit, repousse les limites de l’art. Les situationnistes sont allés jusqu’à confondre art et vie. La transgression a favorisé les hybridations entre les arts et le non-art, le corps (ORLAN, Stelarc, E. Kac, P. Tratnik, bio-art). Si l’art moderne est aujourd’hui plutôt accepté par les publics, ce n’est pas encore le cas de l’art contemporain. L’usage de la transgression a relégué le bon goût aux oubliettes, l’attitude critique de l’artiste peut parfois aller vers la surenchère, pour des raisons variées, stratégiques, commerciales, esthétiques… Cela dit, les transgressions ne sont pas toutes critiques. Dans les années 1990 en particulier, les institutions ont souvent récupéré la transgression artistique, désamorçant la contestation ; les artistes devaient porter l’héritage des luttes de l’art moderne et faire face à la dépendance des subventions. Aujourd’hui d’autres formes de transgressions ripostent à ces récupérations, dans l’horizon d’attente de publics souvent en décalage avec la posture de l’artiste et les déstabilisations dynamiques à l’œuvre. S’interroger sur la réception de l’œuvre, c’est placer les publics au centre. L’œuvre, en poïétique (P. Valéry, É. Souriau, R. Passeron), est considérée comme une pseudo-personne, dans la lutte qui éprouve l’artiste, dans laquelle il se risque, engageant son corps. Et lorsque l’œuvre s’adresse à un récepteur, l’aboutissement va déclencher un commencement, parfois fort éloigné des intentions de l’artiste. Mais W. Benjamin, U. Eco, estiment que l’œuvre reste ouverte, inachevée, même si son apparence semble finie, ce qui fait d’elle une invitation, appelant des commentaires infinis. Oui, l’art peut déranger, susciter des réactions violentes, de l’intolérance, du vandalisme. D. Berthet souligne l’importance de la liberté d’expression et aussi que la réception de l’art reste une question de temps.
Enfin, dans « Art et engagement », deux axes de réflexion s’articulent : comment l’artiste donne forme à son œuvre, c’est-à-dire son engagement dans la pratique et le contenu de l’œuvre, l’implication de l’artiste dans la société. P. Valéry, É. Souriau, R. Passeron analysent la prise de risque, la lutte au sein de l’acte artistique. Les avant-gardes déjà évoquées sont citées et D. Berthet remarque le recul du politique et du social dans l’art à la fin du XXe siècle. Il interroge le potentiel d’action des artistes, à l’aune de la pensée de Sartre qui distingue œuvre engagée et œuvre politique. Pour Sartre l’art n’est pas un langage, la relation entre réel, pouvoir de l’art est analysée. L’acte artistique doit garder son indépendance, être interrogé de l’intérieur. M. Ragon, en 1968, très critique vis-à-vis des musées et leur manière de couper les œuvres de leur contexte, interrogeait le rôle et l’attitude de l’artiste dans la société, entre refus et intégration. Il notait que la société de consommation transforme l’énergie du message protestataire en élément décoratif. En effet, la marchandisation de l’art, le système capitaliste absorbent l’art, mais ce dernier résiste et continue de contester, ainsi que G. Lascault le montre, en 1968, considérant aussi que l’art peut favoriser le changement. La condition de l’artiste aujourd’hui est différente, réseaux, collectifs, groupes d’intervention agissent, à l’ère du capitalisme mondial. Dans le cas de la contre-culture, H. Marcuse reste une référence, dans la production de tout ce qui s’oppose à la culture bourgeoise en proposant des alternatives, par la dérision, la transgression. Dans les nouvelles formes de contestation, S. Porte (Un nouvel art de militer, 2000) analyse des actions ponctuelles, médiatiques, ludiques, absurdes, sensibilisant l’opinion, en développant une utopie du présent, sans organisation explicite.
L’artivisme conjugue art et activisme, dans des pratiques sociales, anticapitalistes, écologistes, antiguerres, altermondialistes, antimondialistes, se réfère aux avant-gardes historiques, se veut libertaire, transgressif, festif, révolutionnaire, transdisciplinaire. La transgression, la dénonciation, l’expérimentation, l’action dans le moment (très situationniste), voient aussi les mouvements féministes s’exprimer, agir (Guerrilla Girls, Pussy Riots), prendre des risques. Les collectifs d’artistes sont des résistances en acte (Critical Art Ensemble, Yes Men), créant des effets de surprise (S. Tunick, Banksy, JR) dans la ville, ailleurs dans le monde, en se prévenant de la récupération.
« Le rôle de l’artiste est de nous donner accès à la turbulence » (p. 160), affirme J. de Loisy. La contre-culture, dit D. Berthet dans sa conclusion, reste un espace éclectique et radical d’invention, de contestation, de résistance, une référence pour l’artivisme actuel. Oui, « L’art est un espace de résistance. Il offre des lueurs d’autres possibles. Il a le pouvoir de créer la surprise, de nous faire vivre des expériences émancipatrices. Il crée des brèches, s’y infiltre, donne à découvrir des ailleurs insoupçonnés. L’art est le lieu où se manifeste la liberté », (p. 161) écrit D. Berthet. Ce livre est un lucide message d’espoir, une invitation à pratiquer, échanger, lutter et créoliser les mondes contemporains, par l’art et avec l’art.
